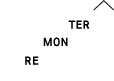Till Rosekens et Marie Bouts partagent la passion des cartes. Cet entretien réalisé à l’occasion de leur exposition Pistes à l’Espace Khiasma à l’automne 2011, revient sur la genèse de leur film Un Archipel qui a depuis beaucoup voyagé en France et à l’international. Découvrez en vidéo deux bonus inédits du film, deux variations sur territoire en mutation.
Olivier Marboeuf : Vous avez tous les deux un intérêt pour la cartographie même s’il ne s’exprime pas de la même manière dans votre travail. L’exposition Pistes prend d’ailleurs l’allure d’une carte géante, à la fois concrète et mentale. Comment se situe cette œuvre dans votre parcours ?
Marie Bouts : L’expérience cartographique est liée au projet dès son commencement. Ni Till ni moi ne connaissions la banlieue parisienne, et la découverte de ce territoire immense, sans bord, labyrinthique, a d’abord été un événement déconcertant : comment l’appréhender ? Comment en rendre compte ? Nous étions complètement perdus !
Mais très vite, nous avons commencé à nous amuser avec les lois de la physique (un peu comme des enfants qui jouent en s’inventant leurs propres règles) et nous avons imaginé que nous étions en train de déambuler dans un espace-temps qui obéissait à des lois particulières. L’espace était en origami et nous pouvions passer d’un endroit à l’autre par le biais de trous noirs, de couloirs secrets, de pliures de l’espace ; nous pouvions nous perdre dans des boucles spatio-temporelles, ou encore marcher sans fin dans un territoire d’apparence rhizomatique, mais qui ne serait en fait qu’une longue ligne déroulée. La toponymie, par exemple, nous guidait pour construire ces imaginaires des lieux (nous avons trouvé une « rue Lénine » dans un nombre incalculable de villes : et si c’était la même rue déroulée ad infinitum ?) En ce qui me concerne, ce rapport imaginaire et symbolique à l’espace-temps est une très vieille obsession, mais jamais encore je n’avais réussi à l’exprimer aussi clairement dans un travail fini, qui puisse voyager seul, sans moi.
Et puis notre source principale d’inspiration, le livre Le Chant des Pistes, de Bruce Chatwin, qui parle des cartographies chantées des aborigènes d’Australie, est un livre très important dans mon parcours personnel. Je l’ai lu il y a une dizaine d’années, et il n’a jamais cessé d’être une référence, un lieu auquel je revenais toujours, fascinée. Cette manière de chanter son chemin me paraissait être un rapport au territoire indépassable, magique et pratique à la fois, quelque chose de très complexe en fait, qui met en jeu plusieurs aspects d’une société (les mythes fondateurs, les transports, l’économie, les relations interpersonnelles, la loi, la poésie…) Du coup, aboutir un projet fondé sur ce livre obsédant, c’est comme si j’arrivais enfin à prononcer un mot qui me tournait silencieusement dans la tête depuis des années et des années. C’est comme une parole enfin délivrée du silence.
Till Roeskens : Marie m’avait prêté ce livre, il y a quelques années. Il avait résonné avec ma propre passion pour le vagabondage. Ce qui est beau, c’est que nous ayons tous les deux repensé à cette histoire au même moment sans en avoir reparlé depuis un bout de temps alors que nous étions dans des lieux que tout opposait au désert australien… sauf peut-être la récurrence des bars appelés “Oasis” qui jalonnaient nos chemins, jamais très loin des rues Lénine. La tentative de mettre en lien ces deux univers, en proposant aux personnes rencontrées qui pour la plupart n’étaient ni nomades ni chanteurs, d’inventer des chants de pistes, nous paraissait d’emblée aussi utopique qu’évidente. Où cette aventure partagée se situe dans nos parcours… l’avenir permettra de le dire ! J’avais déjà travaillé auparavant sur des cartographies subjectives. Ouvrir cette pratique de carte à l’imaginaire plus mythologique des mondes qu’invente Marie me tentait depuis un bon bout de temps… et je crois que la rencontre de nos univers en a créé un troisième, qui n’appartient ni a elle ni à moi. Ce qui fait que ce que nous avons fabriqué là reste joyeusement mystérieux pour nous-mêmes.
Comment avez-vous abordé le Nord-Est parisien ? Le dispositif de l’exposition donne l’impression d’une approche très construite, méthodique et à la fois d’un jeu où l’improvisation, l’errance, l’erreur, trouvent leur place.
T.R : Je ne sais pas ce que tu y vois de méthodique, à vrai dire ! Tout me semble aléatoire dans la construction du film, qui s’est fait sans scénario. Les cartes que nous avons dessinées dans le petit film annexe, comme celles que nous sommes en train de dessiner en ce moment sur les murs de l’espace d’exposition m’apparaissent comme une tentative de comprendre à postériori ce que nous avons fait – en le systématisant un peu, c’est vrai. Le point de départ de notre approche, rappelons-le, c’est la proposition que tu nous as faite de réaliser un film sur ce que tu appelais le « devenir-image de la ville », concept que nous n’avons jamais entièrement compris je crois, donc il serait intéressant de savoir si tu estimes que nous avons répondu à la commande ? Celle-ci ne portait en tout cas pas sur une ville en particulier, mais nous avons décidé de tenter d’y répondre là où tu te trouvais : en Seine-Saint-Denis. Tu nous a parlé alors de ton regard inquiet sur le devenir de ces anciennes « banlieues rouges » qui préparent à grands chantiers leur intégration dans la capitale. Le sujet nous paraissait bien vaste pour l’aborder de front, d’où notre décision de nous laisser guider par le hasard des rencontres…
Comment s’est construit le projet avec les personnes qui traversent le film, le choix des sites, le registre et la forme de leur parole qui sont très particuliers ?
M.B : Nous avons procédé par étapes. Nous passions d’abord beaucoup de temps à raconter le projet, son origine, ses objectifs, son contexte. Ça, déjà, ce n’était jamais une chose simple et rapide, il fallait prendre le temps. Nous n’avions pas vraiment de discours tout prêt, nous devions à chaque fois nous réadapter à l’interlocuteur, à la situation, et aussi à nos propres doutes intérieurs : pendant très longtemps, jusqu’au tournage peut-être, cette cartographie chantée nous paraissait être un projet impossible, Mais les gens ont généralement accueilli l’idée avec beaucoup d’enthousiasme, c’était très étonnant.
Et puis une fois que quelqu’un avait décidé de s’engager, nous abordions le tournage en trois rendez-vous minimum.
D’abord, nous demandions à notre interlocuteur de nous parler des sites qui l’avaient marqué, pour une raison ou pour une autre et nous avons enregistré ces premiers récits.
Pour le deuxième rendez-vous, nous allions ensemble sur le site, et nous recommencions le récit, parfois avec l’enregistreur son, parfois avec la caméra. Ce deuxième rendez-vous était particulièrement intense parce que c’est là que nous abordions le statut particulier de la parole. Nous ne voulions pas d’un récit documentaire classique. Il m’a semblé que c’était comme des ateliers d’écriture personnalisés : on devait écouter très attentivement notre interlocuteur pour l’aider à aller vers une parole poétique, scandée, chantée. Mais c’était important de ne pas lui imposer quelque chose qui ne lui aurait pas convenu, quelque chose qui ne serait pas déjà contenu dans sa propre manière de dire, de parler. Il fallait vraiment, à ce moment-là, ouvrir une oreille très grande, très fine, et avoir du discernement. Parfois, on se trompait et on bousculait un peu nos interlocuteurs. Parfois quelque chose venait très vite. Ce que j’aimais, dans cette étape de travail, c’est que nous devions être à la fois guides et guidés, à l’écoute de cette parole en train de se construire. C’était un moment délicat, sur le fil, parfois un peu violent, mais toujours très émouvant, un peu comme la naissance de quelque chose. Ça prenait ou pas. Enfin, nous avions un rendez-vous pour le tournage. Une grosse demi-journée, en général. Certaines personnes avaient préparé des textes précis, qui étaient des lectures, mais la plupart passaient du temps à improviser, soit en free-style total, soit en fonction d’une trame déjà travaillée.
En vérité, tout ce temps a été très long. Nous avons commencé en septembre 2009 à arpenter les terres du 93, et nous n’avons réellement tournés qu’en juin 2010. Nous venions en Seine-Saint-Denis une semaine par-ci, dix jours par-là, pour faire des repérages. Nous sommes restés dans une première ceinture nord-est, entre Epinay, au nord, et Montreuil, au sud. Nous marchions beaucoup, nous prenions les transports en commun. Nous avions les yeux grand-ouvert, nous voulions tout voir ! C’est là, aussi, dans ces longues marches, que nous prenions conscience des sites que nous voulions chanter, comme le pont de la révolte, par exemple.
Les personnes / acteurs ne se sont jamais rencontrés, finalement, nous avons inventés des liens entre les uns et les autres.
Tous les croisements du film sont des croisements fabriqués au montage, des trucs cinématographiques qui correspondent à ce désir de plier le territoire pour juxtaposer dans le film deux espaces en fait très éloignés dans la réalité.
En découvrant le titre du film, Un archipel, j’avoue que je ne l’ai pas tout de suite associé à l’idée d’un territoire morcelé mais plutôt aux habitants eux-mêmes, perdus dans la solitude de la ville – à l’exception peut-être du couple d’amoureux de Montreuil. Dans le film, même s’il arrive qu’ils se croisent, jamais les personnages ne semblent pouvoir se rencontrer, comme une communauté fantôme. Le film en tire peut-être une certaine mélancolie.
T.R : C’est au montage que le titre nous est venu, en parlant des « îlots » que constituaient les différents lieux et personnes, et que nous montions parfois à part avant d’arriver à les relier. Alors oui, ce sont des trajets solitaires, des pistes qui en croisent beaucoup d’autres pourtant, celles de tous les anonymes. Peut-être une communauté fantôme, oui, peut-être ce « peuple qui manque » dont nous parle Paul Klee par la voix de Deleuze. En deça de la philosophie, c’est que nous avons travaillé sur un territoire très étendu… Nous avions réfléchi à la possibilité d’un atelier collectif, mais avant de pouvoir le mettre en place, nous avions déjà rencontré nos conteurs, par des voies diverses, certains via des réseaux de relations, d’autres sur place dans des lieux qui nous parlaient du bouleversement de ces territoires, tels l’impasse en démolition ou le campement roumain. La plupart des personnes se trouvant donc dans des lieux éloignés les uns des autres, ça a a été toute l’aventure du montage que de tisser des liens entre eux, des rencontres imaginaires, des correspondances secrètes… dont beaucoup échapperont probablement au spectateur.
Les personnages établissent une relation avec vous en plaçant au cœur de l’échange le récit d’un chemin, la connaissance, la mémoire comme trésor, comme monnaie. Apparaît ainsi une manière de parler de la richesse assez singulière, une économie du symbolique.
M.B : Justement, cette économie du symbolique, c’est vraiment quelque chose qui est exprimé, à l’origine, dans Le Chant des Pistes, de Bruce Chatwin. Les humains sont reliés entre eux et à leur monde par le chant, qui est à la fois geste et contenu. Sauf que la communauté des aborigènes australiens existe vraiment (même décimée par les blancs), avec des codes et des légendes en commun qui fondent leur existence en tant que collectif. Ici, nous avons inventé un groupe qui n’existe que parce que ses membres ont accepté de chanter dans le film. Ils n’ont pas, avant, entre eux, inventé ces règles, ces mythes qui soudent les humains en tant que communauté. Ça a un côté très factice, et c’est dans ce sens que ce que nous avons fabriqué est plutôt une fiction qu’un documentaire. Je pense que c’est à cet endroit que tu peux avoir la sensation d’une communauté fantôme, d’une mélancolie : le rêve de la communauté qui chante son territoire n’a pas lieu dans le réel. En plus, ce n’est pas l’initiative de tous, mais le projet de deux. Cela n’a rien de communautaire, au final.
Mais ce qui existe dans le film, c’est un espace imaginaire, que plusieurs personnes ont contribué à bâtir. Ce territoire, nous l’imaginons comme un lieu parallèle, légèrement décollé de la Seine-Saint-Denis réelle, une sorte de sixième dimension où les humains inventent et activent sans cesse le lien magique à leur terre, à leur chemin. Dans ce qui est chanté, j’entends souvent une sorte d’ode au pays, à la vie ; les humains ne dominent pas leur monde, mais font partie d’un tout dans lequel ils trouvent leur place. Comme nous l’a dit Morlaye Touré, « La vie est dure pour les descendants du peuple, tout le monde est né dans ce peuple ».
Ce chant s’élève dans un contexte bien particulier, celui des bouleversements dus à la réalisation du Grand Paris. Du coup, le paysage chanté est un paysage en transition, il n’existe déjà presque plus au moment où on le chante, c’est autre chose qui commence, nous ne savons pas quoi. Pour les personnes qui voient leur environnement être démoli malgré eux, ces transformations sont violentes.
Face à des « machines à démolir », comme les appelle Rafiou Adéjumo dans le film, des voix humaines s’élèvent. On peut se demander, dans ce duel, qui est fort et qui est fragile, qui produit de la richesse et qui produit de la pauvreté. J’aime croire que les voix humaines sont riches et puissantes, parce que justement du côté de l’échange, du symbolique, du lien.
Un archipel est un film à plusieurs voix. Au coeur des voix des hommes et des femmes qui nous guident, vous avez déposé une autre voix en écrivant sur la « peau » de la ville.
Quel est le statut de ces textes ?
T.R : C’est venu de nos tentatives, abandonnées finalement, de dessiner des cartographies de nos trajets à la craie, à même les trottoirs. Les cartes ont disparu – puisque la gageure c’était justement que les cartes du film soient chantées et non dessinées – mais certains mots ou phrases que nous avions écrit sont restés, comme une fiction ténue qui s’infiltre dans les images de la ville réelle.
La logique de pliage de l’espace qui préside le montage du film Un Archipel est surtout rendue sensible au travers du dispositif qui l’environne dans l’espace de l’exposition – avec des cartes, un autre film. Est-il pensé comme une œuvre autonome au risque qu’une part du propos échappe aux spectateurs futurs du film ?
M.B : Il semble en effet qu’un aspect du projet échappera toujours aux personnes qui ne connaissent pas le territoire de la Seine-Saint-Denis. Quelqu’un qui ne sait pas où se situe tel ou tel lieu ne peut pas percevoir les pièges spatio-temporels que nous avons élaborés au montage. Je pense quand même que le film contient des indices de temporalité troubles, et qu’il peut vivre sa vie, parler, chanter, même sans les cartes qui l’accompagnent ici.
Mais nous avons vraiment cherché à construire Un Archipel comme ça. Au début, nous voulions y placer aussi des cartes dessinées (la carte en mouvement du film annexe, la cartographie imaginaire déployée au sol de l’Espace Khiasma), qui auraient rendu visible le processus de pliage, de découpage, de déstructuration de l’espace. Nous avons eu tout un débat sur l’aspect potentiellement surplombant de la carte : en tant qu’outil de compréhension et de représentation globale du monde, la carte place le « regardeur » au-dessus de l’espace qu’il regarde, en position de contrôle, de force. Nous voulions rester dedans, rester perdus, au risque de ne pas expliciter notre rapport farfelu à l’espace. Cette décision mettait en jeu notre posture : je ne voulais pas du tout être une exploratrice, avec ce que cette place suppose de violence historique sur les territoires et les populations explorées (d’autant que la Seine-Saint-Denis accueille beaucoup de personnes qui ont déjà été « explorées » par les blancs, dans un passé très proche, avec les conséquences qu’on connait). Je voulais trouver une place à l’intérieur du monde, en aucun cas être au-dessus et avoir une vision plus large que les autres personnages.
Du coup, notre chant à nous, notre manière de nous perdre, de retrouver notre chemin, de nous interroger, de nous émerveiller, se déploie dans les signes à la craie, dont nous avons balisé le territoire, et dans certaines chansons sans paroles. Till a aussi choisi une manière de filmer qui fait de lui un acteur du film, je trouve : il est pris dans le tissu du monde, à la même hauteur que la rue, que les chanteurs.
Il y a, au coeur du film, une relation particulière à l’Histoire.
T.R : C’est aussi, je crois, ce qui préside au désir de Marie de dessiner une carte qui recouvrirait non seulement le sol, mais également les murs et le plafond de votre lieu : créer un espace englobant, qui ne permette aucun surplomb, et qui situe le spectateur du film en quelque sorte à l’intérieur de celui-ci.
Jean-Marc Chapoulie rappelait récemment lors d’une rencontre à Khiasma l’importance du film comme document, au-delà de son récit, sa force d’archive d’une situation, d’un état du monde physique et notamment l’état de la ville. J’ai l’impression qu’Un Archipel est un film qui pointe, inconsciemment peut-être, un moment précis. Alors que tous les éléments semblent déjà en mouvement pour que s’érige une nouvelle histoire – le Grand Paris ? – les « traces » du passé y jouent un dernier spectacle émouvant.
T.R : Exact.
Propos recueillis par Olivier Marboeuf
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –